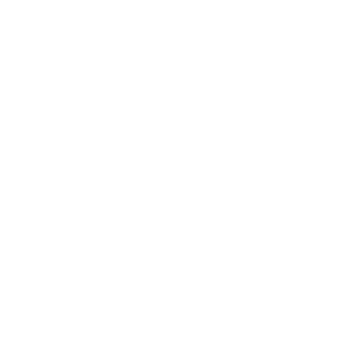Notícias de Imprensa
European Youth Week 1
European Youth Week 2
ODUCAL1
Giving Tuesday 2
European Youth Week 3
L’université inquiète. Entretien sur le temps d’aujourd’hui
Excellence Monseigneur l’Archevêque de Paris et Grand Chancelier de l’Institut Catholique de Paris, Msgr Michel Aupetit
Monsieur le Recteur, Père Emanuel Petit
Chers Professeurs, chers collègues
Chers étudiants
Mesdames et messieurs en vos titres et qualités
Je suis très honorée et touchée de recevoir un Doctorat Honoris Causa de l'Institut Catholique de Paris, héritier de l'une des plus anciennes universités du monde, du temps où toutes les universités étaient traditionnellement catholiques. Je remercie le Recteur, M. Emanuel Petit, et le Conseil des Doyens, ainsi que l'ancien Recteur, M. Philippe Bordeyne, pour la reconnaissance de mon travail académique en faveur du dialogue culturel. En écoutant la laudatio prononcée par le Prof. Dr Cécile Coulangeon, j'ai eu l'impression qu'elle parlait de quelqu'un d'autre que moi. Une ancienne élève de cette institution, Simone de Beauvoir, a dit un jour à Jean Paul Sartre que le sens d'un titre d'honneur était toujours une abstraction et qu'il devait accepter cette condition avec modestie et sans présomption. Avec la clarté choquante qui la caractérisait, Beauvoir disait à Sartre que le titre n'était pas le sien, mais était de ce que Sartre représentait, c'est-à-dire l'univers que son action réalisait.
Je suis donc honorée de cette distinction octroyée pour un parcours qui représente plus de personnes que celle qui reçoit ce diplôme ici aujourd'hui. Tout au long d'une vie de recherche, d'enseignement et de direction, j'ai eu le privilège d'être critiquée et encouragée, d'être mise au défi et d'apprendre que chaque succès ou défaite est une force de croissance. Je reçois donc ce titre d’honneur en remerciant les magnifiques professeurs, les brillants collègues, mes étudiants agités et perspicaces et les partenaires intellectuels qui ont transformé chaque crise en un moment de discernement, qui ont déstabilisé ma zone de confort et contraint à la réflexion critique. En adaptant les vers du poète John Donne, je dirais: "Aucune femme n'est une île, un tout, complet en soi; toute femme est un fragment du continent, une partie de l'ensemble" (Méditation XVII, Devotions upon Emergent Occasions, 1624).
C'est à partir de la prise de conscience de la vie en tant qu'écologie, qui met en relation diverses manières de voir et d'évaluer la réalité, et du travail sur le conflit comme moyen de rechercher des articulations, que j'ai construit des travaux de recherche et développé des stratégies de leadership. Je crois qu'à notre époque inquiète, la lutte contre les monocultures, qu'elles soient disciplinaires, politiques, culturelles ou économiques, est cruciale si l'on veut que l'avenir soit possible. Une attitude écologique va bien au-delà de la dimension biologique qui l'inspire étymologiquement. Dans notre époque agitée, elle est sociale, politique, culturelle. Comme l'affirme le pape François dans l'encyclique Laudato Si, elle est intégrale. Et une écologie intégrale est nécessairement aussi institutionnelle (LS, 142), ou elle ne l'est pas.
En cette période d'inquiétude, l'institution universitaire ne peut se distancer d’une demande radicale de refiguration écologique. Les problèmes complexes de notre époque ne peuvent être résolus sur des îles ; ils exigent l'action de multiples protagonistes, ils exigent le pluralisme, ils exigent le dialogue et l'engagement. Touchés par une pandémie qui avait été anticipée mais à laquelle nous étions désespérément mal préparés, nous avons vécu ces 22 derniers mois dans un état d'exception et de suspension. L'exception sanitaire nous a obligés à suspendre les logiques de la vie quotidienne et a donné lieu à une réflexion individuelle et collective sur les conditions de la modernité tardive. Bernard Henry Lévy a évoqué le remplacement du contrat social par un contrat vital (Lévy, 2020 : 80), selon lequel un sentiment généralisé de crise fait naître un sentiment de disqualification irrémédiable, source d'une crise de confiance protectrice et d'une mélancolie qui n'en finit pas. Je parle de la défaite des promesses de la mondialisation, du capitalisme global, en Europe la crise de l'Etat social notamment suite à la crise de la dette souveraine. En outre, cette blessure nourrit durablement le sentiment d'une trahison des élites. Mais cette réaction traverse les temps. Nous l'avons vécu il y a peut-être cent ans, et nous connaissons aussi ses effets tragiques.
En fait, après la tragédie des deux guerres mondiales, la cristallisation politique en deux blocs antagonistes séparés par un rideau de fer symbolique et la projection de ce conflit froid en scénarios chauds et asymétriques à l'échelle mondiale, nous avons cru, à la fin du XXe siècle, que le temps avait pris fin et que l'utopie éthique d'une humanité essentielle était réalisée. À la fin du siècle, nous avons connu la voracité de la complétude. Avec la fin de la guerre froide, nous avions atteint la paix universelle. L'ère de la pax americana a également marqué la victoire de la démocratie en tant que modèle politique hégémonique qui a entraîné l'affirmation du capitalisme et, avec lui, la mondialisation économique, annonçant la fin de de la pauvreté et de la famine. Dans le monde transformé en un village global, nous vivions connectés, interdépendants, la technologie et la science promettaient le meilleur des mondes et la conquête des maux qui affligeaient la race humaine. Nous avions donc conquis la paix, vaincu la pauvreté et dominé la maladie. La modernité avait accompli ses promesses d'émancipation, de liberté, de prospérité, de bonheur, comme le disait la Constitution des États-Unis d'Amérique de 1787.
Alors que nous entamons la troisième décennie du nouveau siècle, nous savons que modernité est un mot équivoque et peut-être faux (Ramalho Santos, Sousa Ribeiro 2008: 2) qui semble avoir besoin d'un complément pour remplir son mandat de signification, car le terme aborde l'aporie du temps inachevé, exposant le désir recherché mais toujours refusé de capturer l'instant fugace. Et d'autre part, du point de vue de la chronologie, l'idée même de moderne présente l'échec de l'histoire, se constituant comme un mouvement de dénonciation du passé. Comme le souligne Andreas Huyssen, le moderne est marqué par le traumatisme du passé présent, qui retranche le rêve d'un futur présent (2003, 11). Il semble donc que la modernité ne puisse se prononcer que sur un mode pré ou postmoderne, comme un processus inachevé voué à être emporté par la brise du progrès tel l'ange de l'histoire de Walter Benjamin, regardant en arrière et observant un tas de gravats. La modernité est donc toujours multiple, inaboutie, contradictoire, oscillant entre de bonnes intentions réformatrices et une pulsion violente et autoritaire. C'est dans cette tension, d'un temps toujours indompté et sauvage (J.Gil, 2020) mais qui veut s'accomplir avec de bonnes intentions, que Charles Baudelaire a observé le mal intrinsèque au processus de la modernité. "On n'est jamais excusable d'être méchant, mais il y a quelque mérite à savoir qu'on l'est; et le plus irréparable des vices est de faire le mal par bêtise."
La bêtise est en fait le grand accélérateur de l'histoire. Lorsque nous regardons la réalité de notre époque, nous observons l'effet d'une certaine bêtise stratégique dans la prise de décision politique concernant les conflits qui nous entourent - de l'attentat du 6 janvier contre le Capitole au conflit entre la Biélorussie et l'Union européenne à la frontière polonaise - dans l'hésitation quant à l'orientation vers une politique environnementale durable, dans la difficulté à reconnaître les appels à la justice distributive de la part des populations en situation de précarité, dans la polarisation du débat sur la justice sociale et sa contamination par les moralismes de la wokeness transatlantique. Nous connaissons le somnambulisme que l'historien Christopher Clark a décrit comme ayant conduit le monde à la Première Guerre mondiale, et Marc Ferro a décrit le ressentiment comme un agent de l'histoire. Aujourd'hui, dans une modernité inquiète et sauvage, nous vivons à l'heure de la bêtise stratégique. Cette bêtise n'est pas ignorante, et dans certains cas elle peut même être bien intentionnée, mais dans la plupart des situations elle est profondément cynique, car son action est stratégique. Son problème est qu'elle n'a pas de conscience, pas de valeurs. Elle agit en surface, en utilisant une communication partielle, voire fausse, diffusée par des plateformes digitales, pour conquérir la population la plus (des)informée qui soit, précisément parce que c'est celle qui a toujours eu le plus accès à l'information. La bêtise stratégique crée des 'idiots utiles' ou favorise l'éducation des crétins digitaux, selon le terme de Michel Desmurget. C’est à nous de les arrêter!
L'université inquiète. Elle constitue l'espace d'autocritique propre à la modernité tardive, et se remet chaque jour en question, mais elle est aussi perçue comme dérangeante et à la fois inutile. Je parle tout d'abord du discrédit politique et social. Depuis 2016, l'université ne figure pas dans les discours de l'Union européenne sur l'état de l'Union. Souvent elle est invoquée comme référence marginale sur l'employabilité des diplômés. Or, l'Europe et les universités sont marqués par une sorte de pollinisation croisée. Bien que la formation académique ne soit pas un privilège européen exclusif, il n'y a pas d'Europe sans université et vice-versa. Institutionnalisée au XIe siècle en Europe en tant que projet de formation des élites de l'Église, l'université a joué un rôle déterminant dans le développement divers des sociétés européennes et de leurs cultures.
Néanmoins, l'existence de centres de connaissances structurés n'est pas une idée européenne. La bibliothèque d'Alexandrie faisait partie du Musaeum d'Alexandrie qui ressemblait à un campus universitaire moderne, car il comprenait des amphithéâtres, des salles de réunion et des espaces de restauration. L'Académie des sciences de Bagdad, au 9e siècle, était un centre d'apprentissage. À Pékin, au 3e siècle, il existait une académie pour la formation des fonctionnaires impériaux, le Taixue. Certains centres bouddhistes en Inde, comme à Nalanda et Taxila, ont rassemblé un grand nombre d'étudiants jusqu'à environ 1200, atteignant environ 10.000 résidents (Palfreyman, Temple : 2017). Et pourtant, bien que de l'Akademos grec au Bayt-al-Hikma arabe, à Bagdad, des centres de savoir aient fait surface dans tout le monde connu, la création et le modèle spécifique de l'université sont européens, développés il y a plus de 1000 ans dans les salles des écoles cathédrales, puis dans les académies de Paris, Bologne, Oxford, Lisbonne et d'autres endroits.
Avant même que l'Europe ne s'ouvre à l'exploration, et à l'exploitation, de géographies inconnues, s'élargissant à "toute la variété" des expériences et des formes de vie, l'université était déjà une entreprise internationale. L’université de Thomas d’Aquin a été si internationale que l’université moderne, née en Prusse dans les premières décennies du XIXe siècle comme instrument politique au service de la projection nationale du pouvoir. La réforme de Wilhelm von Humboldt et de Friedrich von Hardenberg a donné naissance à l'université de recherche moderne dont l'objectif était d'établir l'unité de l'enseignement et de la recherche, ainsi que de défendre la liberté d'enseignement (Lehrfreiheit) et d'apprentissage (Lernfreiheit). L'université moderne a donc été conçue dans le sillage de ce que l'on appelle "l'aube de l'ère du peuple", et s'est attachée à renforcer l'État-nation en tant que formation politique dominante et à mettre en œuvre un nouvel ordre économique issu de l'industrialisation. Rien de plus étrange, qu’aujourd’hui, dans l'Europe post-nationale, l'université devienne simplement un fétiche du jeu politique.
La projection de l'Europe à travers les universités européennes et l'espace européen de l'enseignement supérieur n'est pas une réalisation récente de la virtuosité politique de Bruxelles. De l'université européenne comme projet inquiète qui promeut l'agitation est née la grammaire de la création de l'Europe, ses valeurs et son projet constant d'aller au-delà, sans limites, sans tabous, mais avec conscience. Et c'est cette conscience qui fait défaut dans la rhétorique du lien entre l'université et l'employabilité, qui sert les objectifs technocratiques de certaines politiques européennes.
L'idée de l'Europe-université lamine le célèbre discours d'Emanuel Macron à la Sorbonne en 2017, dont il dit que " la seule façon d'assurer l'avenir est de rétablir une Europe souveraine, unie et démocratique. " Une ligue d'universités européennes d'élite s'érigerait en avant-garde de cette politique. À cette fin, l'université est un outil, et non un protagoniste. Il sert un but, il ne le détermine pas. En bref, l'institution qui a créé l'Europe des idées et avec des idées sert désormais une certaine idée de l'Europe. L'Europe de l'innovation, de la croissance, de l'esprit d'entreprise, de la créativité, de la durabilité, de la sécurité, de la justice, de la démocratie, de l'employabilité veut être reproduite dans les stratégies des 41 alliances d'universités créées dans le cadre de cette grande initiative. Et pourtant, cette Europe n'est peut-être pas suffisante. Dans son discours sur l'état de l'Union, la Présidente Ursula van der Leyen a appelé à la création d'une nouvelle âme pour l'Europe, invoquant Robert Schumann lorsqu'il a déclaré que "l'Europe a besoin d'une âme, d'un idéal, et de la volonté politique de servir cet idéal". À Rome, au moment de la reconstruction, il fallait faire de l'idée d'Europe un idéal de paix, de solidarité, de croissance, de démocratie. Il était également nécessaire d'avoir "un acte béni d'oubli/ a blessed act of oblivion" parmi les ennemis d'hier, comme l'a souligné Winston Churchill en 1946 dans son célèbre discours de Zurich.
L'Europe d'aujourd'hui a rempli les promesses de Rome, mais elle risque toujours de perdre son âme. Il est remarquable que le nouveau programme de stages pour les jeunes lancé par la Commission porte le nom approprié d'ALMA (âme). Néanmoins refaire l'âme est plus exigeant que de proposer un idéal. Et construire une âme "nouvelle" suggère la banalité du nouveau qui frappe une certaine modernité fatiguée de soi. Fernando Pessoa, dont le Livre de l'Inquiétude a été considéré par Alain Badiou comme le chemin de fer d'une modernité devant nous, a décrit de manière symptomatique l'excès de nouveauté comme le sentiment moteur d'une existence moderne, dans laquelle les individus "ont déjà (vu) tout ce qu'ils n'ont pas encore (fait) voir." Dans ce milieu, on vit "l'ennui du toujours nouveau, l'ennui de découvrir sous la différence passagère des choses et des idées, l'identité pérenne de tout, la similitude absolue entre la mosquée, le temple et l'église, l'égalité de la cabane et du château, le même corps structurel pour être roi vêtu et sauvage nu, l'éternelle concordance de la vie avec elle-même, la stagnation de tout ce qui vit dans le changement auquel il est condamné." (Pessoa, LDI: 369)* Peut-être que, aujourd'hui comme hier, nous vivons l'ennui du nouveau. Et l’ennui peut contaminer l’université.
Les descriptions courantes de ce que fait une université ont souvent recours à la comparaison. Elles sont ainsi définies comme des "usines à savoir" ou comme "un marché aux idées" (Louis Menand), c'est-à-dire un lieu d'échange et de négociation, où la complexité du tissu social se reflète dans le dialogue fructueux entre les disciplines et les méthodologies. Ces derniers temps, nous avons assisté à une prise de conscience croissante du fait qu'une université - en tant qu'organisation complexe - qu'elle soit publique ou privée, est tenue de respecter des normes élevées en matière de responsabilité et d'obligation de rendre des comptes, notamment vis-à-vis de ses étudiants, dont la qualité témoigne de l'impact plus large de l'institution. Et comment s'y prendre ? Les plans stratégiques des universités, au lieu d'identifier des forces uniques et des orientations futures, sont presque identiques. Stefan Collini, dans What are Universities for? nous avertit que le "Edspeak" a colonisé nos esprits. Notre recherche doit être compétitive, révolutionnaire, à la pointe du progrès, pertinente, applicable, transférable, génératrice de profits et... facilement conditionnée pour être diffusée dans les médias. A notre époque, l'université se rapproche dangereusement de l'usine. Elle se normalise avec la règle de la mesure et de l'impact, l'accent mis sur les résultats et sur la matérialité de la création de valeur. Cela se produit alors que l'université est de plus en plus séduite par le glamour de l’entreprise régi par des modèles d'efficacité, de croissance et d'innovation.
Réduire la valeur d'une éducation au débat utile/inutile n'a été qu'improductif. À la fin des années 1800, lorsque les nouvelles universités de Liverpool et de Birmingham ont été fondées avec la mission de fournir une éducation professionnelle à la jeunesse, un pamphlet d'Oxford plaisantait sur l'avilissement qu'un tel modèle entraînerait : "Il obtient des diplômes pour faire de la confiture/ à Liverpool et Birmingham" (“He gets degrees in making jam/ At Liverpool and Birmingham,”), en méprisant les diplômés dans des domaines vulgaires comme l'ingénierie. Plus tard au XXe siècle, le président de l'université de Chicago, Robert Maynard Hutchins, a écrit dans The University of Utopia (1953) que "le but de l'éducation n'est pas de produire des armes pour l'industrie ou d'apprendre aux jeunes à gagner leur vie. Son but est d'éduquer des citoyens responsables". Mais si, sans la proposition de main-d'œuvre et de compétences, audelà de la logique du value for money, où se trouve la valeur de l'enseignement universitaire au XXIe siècle ? Comment l'université peut-elle conserver sa pertinence avant la disparition de la culture de l'expert et devant l'iconoclasme tapageur de la société de la connaissance fondée sur les données/data ? Et dans cette énigme, quelle est la valeur de l'enseignement supérieur catholique?
Je risque une proposition: la singularité unique de notre mission est de créer de la valeur avec des valeurs. Et pour commencer, il serait utile de se pencher sur ce que l'ancien vice-chancelier de l'Université de Newcastle, Chris Brink, appelle " l'âme de l'université " (Brink, 2018:xv), pivotant autour de deux questions principales qui définissent fondamentalement toute entreprise universitaire: En quoi sommes-nous bons ? Et à quoi sommes-nous bons ? Ces questions sont au cœur de notre identité, de notre mission et de notre activité. Elles évoquent la quête ancestrale de la vérité et du bien. Ce à quoi nous sommes bons, c'est à rechercher sans relâche la vérité à travers la recherche et l'enseignement, et dans la rencontre quotidienne avec les personnes que nous représentons : les étudiants, les enseignantes, le personnel et les parties intéressés (stakeholders) de notre troisième mission. Ce pour quoi nous sommes bons, c'est pour contribuer au bien de la société, en nous efforçant d'approfondir le dialogue pour mener une vie digne, au service de notre maison commune. Mais aussi de comprendre que notre mission est commandée par des valeurs humanistes, que notre raisonnement est enrichi par la foi tout comme la foi est élargie par la raison (Fides quarens intellectum). Et comme Jésus l'a expliqué au docteur de la loi dans la parabole du bon Samaritain, l'ouverture à la diversité, à l'altérité doit être embrassée et ne fera qu'enrichir notre mission en renforçant notre pertinence pour faire face à la complexité incertaine de notre monde, parce que "Par l'échange de dons, l'Esprit peut nous conduire toujours plus loin dans la vérité et la bonté". (EG 246).
Or l'université, moteur de la croissance et du développement, est aussi le bastion d'une manière de vivre ensemble, d'un ensemble de valeurs et de droits. Les idées profondes qui ancrent l'européanité, si nous voulons l'appeler ainsi, ont été développées et apprises dans les espaces palpitants des académies européennes: la défense de la dignité de l'individu, la lutte pour la liberté et le libre choix, l'État de droit, la démocratie représentative, l'État-social, le droit à la mémoire, à l'éducation, à la santé, au travail, comme l'a dit Hannah Arendt, le droit d'avoir des droits. L'université inquiète combine le désir palpitant de connaissance avec un activisme éthique en faveur d'une citoyenneté intégrale. Elle sera toujours agitée par l'exigence d'une autonomie responsable, par le droit à la parole de tous les membres de sa communauté, par l'inspection critique du pouvoir. Mais cette inquiétude doit aussi toucher son organisation.
Comprendre ce qu'elle est, comment elle fonctionne et ce qu’elle signifie sont des questions fondatrices du geste qui sous-tend toute pratique académique, un ensemble de questions qui présupposent à leur origine une épistémologie écologique. Comme nous le savons bien, l’ensilotage disciplinaire est une création de l'ordre du savoir rationaliste. Sous prétexte d'analyse approfondie, la décomposition du problème en tranches indépendantes produit la perte de la notion d'ensemble. La branche de l'arbre est observée, mais pas la forêt. La monoculture académique constitue la menace interne ultime pour l'écologie intégrale en tant que proposition profonde de redéfinition du modèle de production de savoir de l'université. Elle se manifeste par la rigidité disciplinaire, par le privilège corporatif qui limite l'accès aux catégories les plus élevées de la profession, notamment pour les femmes. Dans l'Europe de 2021, nous n'avons toujours que 26% de femmes aux plus hauts postes de la carrière universitaire et seulement 23% de femmes sont à la tête d'institutions. En tout cas, une avancée retentissante de 7% par rapport à 2015.
L'écologie intégrale demande à être reconnue. Dans le milieu universitaire, comme dans la société, une pratique de reconnaissance qui favorise un véritable dialogue disciplinaire et non une simple tolérance transdisciplinaire ; qui promeut l'interdépendance ou la complémentarité des connaissances scientifiques produites dans l'académie avec d'autres réalités et pratiques externes, notamment locales, y compris le dialogue avec les savoirs informels. Elle passe également par la reconnaissance de la diversité de sa communauté de chercheurs, d'enseignants, d'étudiants, de collaborateurs, qui, dans les sociétés ouvertes dans lesquelles nous vivons, est de plus en plus multiculturelle et multilingue. Enfin, elle demande que cette communauté se reconnaisse dans les instances dirigeantes scientifiques, universitaires et gouvernementales. Dans un court texte publié en 1934 dans le journal étudiant du Somerville College d'Oxford, intitulé "Why", Virginia Woolf s'interrogeait à juste titre sur l’abîme entre la communauté des étudiants et les enseignants, sur l'inadéquation du modèle de la lecture/ la leçon magistral à la réalité vécue par les étudiants et sur la distinction absurde qui éloignait ces maîtres de partager une humanité commune. Avec clarté, elle a dit: "Pourquoi encourager vos maîtres à se transformer en fanfarons et en prophètes alors qu'ils sont que des hommes et des femmes ordinaires?"
Pourquoi ? La question annexe de la recherche scientifique doit continuer à nous animer pour repenser l'université, son organisation, sa place, ce qu'elle fait de bien, l'héritage qu'elle préserve et les récits lourdes qu'elle doit rejeter, notamment les dérives du passé qui ont conduit à la discrimination et au sectarisme.
C’est pourquoi une inquiétude structurel doit être cultivée au sein de l'université . Nous sommes l'institution que nous sommes, précisément parce que nous avons toujours été plus qu'une institution. L'inquiétude comme stratégie exige, après tout, que l'université se remette en question et devienne un studio de transformation agité vers un monde meilleur. Et que, ce faisant, chacun puisse s'exprimer, sans annulation. L'académie est l'espace de liberté, par définition, où la vérité est recherchée, où le pluralisme est de droit. Déguisé sous une apparence de justice sociale, le moralisme woke de la cancel culture est une bêtise cynique. Dans l'histoire de l'humanité et partout dans le monde, l'université a été d’avantage un espace de résistance aux autoritarismes de toutes sortes (politiques, religieux, économiques). Il est vrai que tout n'est pas ou n'était pas parfait, car l'université aussi reflété la structure de sentiment des sociétés dans lesquelles elle s'est insérée, mais elle est toujours en devenir, en train de se améliorer. Comme l'écrit la jeune poétesse américaine Amanda Gorman dans son poème "The Hill We Climb", le système "n'est pas brisé, mais simplement inachevé"/“isn’t broken, but simply unfinished”. L'université, c'est nous, et il est de notre responsabilité d'en prendre soin comme d'un espace inclusive, d'ouverture, pour les générations futures. Avec l'inquiétude comme stratégie et le service à la société comme mission.
Je souhaite à tous les étudiants, enseignants et membres des organes de direction de l'université, que je salue en la personne de son Recteur, une année académique riche dans la poursuite de la connaissance.
Merci beaucoup.
Isabel Capeloa Gil
18-11-2021
* “Já (viram) tudo o que ainda não (tinham) visto.” Neste ambiente vive-se “O tédio do constantemente novo, o tédio de descobrir sob a transitória diferença das coisas e das ideias, a perenne identidade de tudo, a similhança absoluta entre a mesquita, o templo e a egreja, a igualdade da cabana e do castello, o mesmo corpo estrutural a ser rei vestido e selvagem nu, a eterna concordância da vida consigo mesma, a estagnação de tudo que vive na mudança a que está condemnado.” (Pessoa, LDI: 369)